Dans cet ouvrage fondateur, l’historien et analyste du discours Marc Angenot a brillamment mis en évidence les caractéristiques typologiques du genre pamphlétaire. Celles-ci permettent d’éclairer les affinités voire l’imbrication de ce dernier avec les théories du complot, qui se développent alors fortement et qui y ont trouvé, sans nul doute, un puissant et redoutable catalyseur.
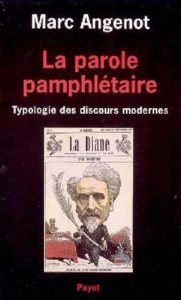
Texte violent, et généralement court, attaquant les institutions ou un personnage connu, le pamphlet est un genre politico-littéraire qui a connu son heure de gloire en France à la fin du XIXème siècle, époque à laquelle il se diffuse largement dans l’espace public, par le biais notamment de la presse. Dans un ouvrage fondateur (1), l’historien et analyste du discours Marc Angenot (2) a brillamment mis en évidence les caractéristiques typologiques du genre pamphlétaire. Celles-ci permettent d’éclairer les affinités voire l’imbrication de ce dernier avec les théories du complot, qui se développent alors fortement (3) et qui y ont trouvé, sans nul doute, un puissant et redoutable catalyseur.
Dans cette ambitieuse étude, Marc Angenot est parti d’un corpus de plusieurs centaines de pamphlets couvrant une période d’un siècle (1868-1968) pour faire ressortir, de manière idéaltypique, au-delà donc des variables divergentes de chaque texte, les traits tendanciels de ce genre, ce qu’on peut appeler ses topoï, dont l’organisation cohérente est, selon lui, porteuse de « symptômes idéologiques ». Suivant Marc Angenot, la spécificité de la posture du pamphlétaire tient au fait que ce dernier prétend affronter l’imposture, mais que cette imposture, à ses yeux, domine le monde. Autrement dit, le monde que contemple le pamphlétaire est un monde dégradé, où le faux s’est substitué au vrai, où le mensonge règne, où l’inversion des valeurs triomphe. De ce point de vue, la vérité que clame le pamphlétaire lui apparaît, bien qu’aveuglante, inaudible dans ce contexte. C’est cette dialectique fondamentale entre vérité et imposture qui nourrit, chez le pamphlétaire, une vision conspiratoire du monde : il « n’affronte pas une poignée d’imposteurs, mais une vaste conspiration, une cabale aux limites floues qui s’appuie sur la lâcheté et la duperie générales. Le pamphlétaire, solitaire, affronte une hydre, un monstre protéiforme » (4).
D’où toute l’ambiguïté du rapport à l’argumentation du pamphlétaire. Puisque, dans son axiologie, les discours et les chiffres officiels sont nécessairement falsifiés, que la science légitime ne peut servir que les intérêts des puissants, le pamphlétaire avoue ne pas être en mesure de convaincre ou de démontrer rationnellement ; il en appelle donc à la conviction intime, au for intérieur de ses lecteurs, sollicitant leur connivence et mobilisant une rhétorique de l’évidence qui fonctionne à grand coup de stéréotypes et de pathos. Le pamphlet relève donc d’un stratégie qui consiste à revendiquer haut et fort son extériorité vis-à-vis des appareils partisans et des institutions académiques, médiatiques et politiques, nécessairement corrompues, pour brandir son indépendance comme le gage de l’authenticité et de la pureté de sa parole : « en insistant plutôt sur ce qu’il n’est pas que sur ce qu’il est, il se construit un éthos paradoxal qui tire une légitimité du fait même qu’il est illégitime, (…) hors du groupe, incompétent » (5). Le franc-parler du pamphlétaire, la violence de son langage viennent, dès lors, marquer non seulement son refus des faux-semblants et des valeurs dominantes mais aussi sa tentative, un peu désespérée, de se faire entendre ; le pamphlétaire se présente, en effet, comme un prophète criant dans le désert ou lançant son message tel une « bouteille à la mer », car il est persuadé que ses efforts resteront vains. Marc Angenot qualifie ainsi le pamphlet de genre tendanciellement réactionnaire, dans la mesure où le pamphlétaire se complaît dans le ressentiment en étant incapable d’investir des espoirs de transformation sociale dans les crises qui affectent la modernité.
Le pamphlet, tel que l’analyse Marc Angenot, apparait donc comme « un cas singulier de la pratique idéologique » dont on trouve les modèles dans les écrits de Rochefort, Drumont, Bloy, Tailhade, Péguy, Céline entre autres, mais dont certains ressorts cognitifs et politico-rhétoriques sont communs à tous les discours du ressentiment dans lesquels prospèrent la pensée conspiratoire (6). Aussi, si ce type de pamphlet, qui a connu son âge d’or en France sous la Troisième République, semble aujourd’hui en déclin (au sens où il ne parvient plus, comme à cette époque, à dessiner les frontières d’un espace critique autonome, identifiable par ses acteurs, ses lieux et ses interactions), il ne semble pas avoir, pour autant, complètement disparu des rhétoriques contemporaines (7).
Notes :
(1) Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Payot, Paris, 1982 (réédité en 1995).
(2) Marc Angenot occupe la chaire James-Mc Gill d’étude du discours social à l’université Mc Gill de Montréal. Son site personnel : marcangenot.com.
(3) Raoul Girardet parle du XIXème siècle européen comme de « l’Age d’Or de la Conjuration ». Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Le Seuil, collection Points Histoire, 1990, p. 59.
(4) Marc Angenot, ibidem, p. 92.
(5) Emmanuelle Danblon, La fonction persuasive, Armand Colin, 2005, p. 53.
(6) Marc Angenot, Les idéologies du ressentiment, Montréal, XYZ, 1996. Dans un de des récents ouvrages, Marc Angenot développe, en quelques pages très stimulantes, la « connexité de la pensée conspiratoire et de la logique du ressentiment » : voir Marc Angenot, Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Mille et Une Nuits, 2008, pp. 343-350 en particulier.
(7) Michel Hastings, Juliette Rennes et Cédric Passard (dir.), « Que devient le pamphlet ? », Mots, n°91, novembre 2009.
L'auteur :
Cédric Passard est PRAG de sciences sociales à l'Institut d'Etudes Politiques de Lille, doctorant au CEPEN. Il travaille sur le pamphlet politique.
Voir aussi :
Depuis dix-huit ans, Conspiracy Watch contribue à sensibiliser aux dangers du complotisme en assurant un travail d’information et de veille critique sans équivalent. Pour pérenniser nos activités, le soutien de nos lecteurs est indispensable.